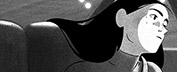Je me sens obligé d'intervenir en tant que personne conquise.

Mais d'abord merci pour l'info ! J'aurai pas supporté de passer à côté.
Etonné de voir autant d'avis mitigés ici. Je connais bien la filmo de Kon et j'ai vu dans ce
Paprika une sorte de film somme, pas un best of, mais un film qui prend comme sujet son propre cinéma. Beaucoup de cinéastes ont récemment fait ce genre de démarche, avec des résultats souvent très décevants (Shyamalan, Kitano, entre autres), alors que dans
Paprika, on sent un enthousiasme vraiment communicatif et une inspiration constante. Un film plus plastique que classiquement attaché aux personnages (bien qu'à la fin, il y ai qiuand même une belle sensibilité bien présente).
Bref, je commence à paraphraser mon avis, copié/collé de celui-ci :
Paprika a tout du film concept et pourtant il est avant tout un divertissement expansif et généreux. On sent un enthousiasme fou dans cette œuvre à la limite d’une euphorie perpétuelle. Totalement communicative. Si bien que le film paraît accessible à tout public n’ayant pas peur d’un grand huit cinématographique.
Si l’on voulait vraiment chercher à redire, juste pour essayer d’échapper momentanément au torrent de superlatifs et aux onomatopées d’extase un peu primitives qui viennent immédiatement après sa vision, on pourrait asséner que le film est victime de son système qui prend souvent le pas sur l’émotion. On pourrait. Mais non. Il serait de trop mauvais esprit de juger le film sur ce qu’il n’est pas, sur cette facilité évitée d’aller directement aux classiques raccourcis sentimentaux. Car Paprika n’est pas dénué d’émotion, celle-ci est juste distillée habilement au milieu d’un incroyable tourbillon de sensations.
La séquence prégénérique très depalmienne dans sa proposition de « matrice originelle » (comme le plan-séquence de Snake Eyes elle sera décortiquée par la suite, mais ce n’est ici qu’une partie du film !) laisse place à un magnifique générique où Paprika virevolte dans la ville telle le double de Mima sur la musique de Susumu Hirazawa, qui prend le risque de la techno-pop entraînante et acidulée.
Dès l’ouverture, le programme est annoncé : « it’s showtime ! »
On a souvent reproché à Satoshi Kon de réaliser des films réalistes qui pourraient tout aussi bien être faits en prises de vues réelles. Mais il profite au contraire pleinement de la spécificité de l’animation, pour rendre avec aisance ses idées visuelles qui dans un film live seraient phagocytées par les effets spéciaux. Car dans l’animation, même avec un fond réaliste, chaque distorsion physique, chaque intervention imaginaire, est acceptée car le pacte du « tout est possible » est implicitement passé avec le spectateur.
Satoshi Kon est un véritable auteur et l’on n’a pas attendu ce dernier film pour le constater. Avec relativement peu de films à son actif, il a déjà constitué une véritable œuvre. Et dans le sommet jubilatoire qu’est Paprika on reconnaît ici ou là des ingrédients tirés d’anciens opus sans que jamais cette récurrence se fasse répétition inutile.
On retrouve beaucoup de Paranoïa Agent; néanmoins, et c’est une des surprises, délesté au maximum de l’observation sociale avisée qu’on lui a connu depuis ses débuts. Bien sûr, les personnages sont ancrés dans un Japon contemporain - notamment un génie de l’informatique presque otaku - mais jamais l’observation de ses contemporains ne prime sur l’intrigue et ce besoin constant d’aller de l’avant, de raconter. Le récit pour le récit, la mise en abyme sans cesse renouvelée, multipliée, le plaisir des pièges, de la manipulation, de l’illusion, tout concourt ici à donner pour sujet le cinéma en lui-même, la manière de raconter des histoires avec des images en mouvement et des sons, à la sauce Satoshi Kon. Sa série télé nous donnait à voir un panel de personnages « réveillés » par un mystérieux protagoniste armé d’une batte. Ici, on a au coeur de l’histoire la facétieuse Paprika, qui parcourt les rêves en apportant son aide, non pas pour littéralement réveiller les gens, mais pour éveiller le lien avec la réalité, sans jamais donner une solution clé en main comme dans un banal film policier. On a ici une thématique très importante du film qui est celle du jeu, de pistes, d’enquêtes, de faux-semblants, de miroir, etc...
Quand le DC Mini, procédé qui permet de rentrer dans les rêves, est dérobé, les choses sérieuses commencent. Mais le cinéaste lui, continue à jouer, avec les motifs, les altérations du réel, les visuels décomplexés des rêves. La détective onirique aura fort à faire pour démêler les fils de l’intrigue, complexe, mais le déroulement est d’une limpidité confondante à l’image. Kon nous balade mais ne nous perd jamais. Et c’est quasiment un exploit tant le récit semble partir dans tous les sens alors qu’il n’en est rien. On retrouve ainsi la structure d’univers mental de la dernière partie de Perfect Blue, où Kon sondait littéralement l’esprit torturé d’une jeune chanteuse harcelée, ainsi que des incursions dans le cinéma comme dans Millenium Actress, l’humour joyeuse de Tokyo Godfathers, bref un kaléidoscope de son cinéma. Sauf qu’ici tout est multiplié, et nous sommes vite face à des situations folles, ne relevant plus du simple passage rêve/réalité, mais de l’agrégat onirique des songes de plusieurs personnages, de réalité virtuelle, de fictions à l’intérieur de la fiction, de récits parallèles, d’autres qui fusionnent pour aller jusqu’à l’inévitable contamination.
Prenant pour thème principal la belle mécanique de son cinéma, le film n’en demeure pas moins touchant, mais à retardement, et d’une façon extrêmement subtile et efficace. Il n’oublie jamais ses personnages car même s’il met en avant pendant une bonne partie le dispositif, l’étalage des mondes et l’entrechoquement des rêves, l’humain est toujours là en filigrane pour amener une conclusion douce et apaisante. Au-delà du grand ride de l’imaginaire, on trouve tout de même des messages discrètement amenés et d’autant plus éloquents qu’ils sont en contraste et en reflet avec le déluge esthétique.
On est ici au bout du système Satoshi Kon. Si bien qu’après telle fête, on se demande avec une pointe d’appréhension quelle pourra être la suite de sa carrière. Comment va-t-il gérer ce film somme, cette apothéose de son style ? La maîtrise de cet artiste exceptionnel, jamais démentie pendant 90 minutes, rassure sur sa probable clairvoyance à ce sujet. Car contrairement à de nombreux grands auteurs contemporains, qui se sont eux aussi récemment penchés sur leur œuvre à travers leur dernier opus (de Gilliam à Kitano en passant par Shyamalan), cette quasi-introspection n’est pas autiste et douloureusement répétitive, elle est au contraire diablement consciente d’elle-même et d’une joyeuse aisance, comme un point d’orgue à une carrière décidément très impressionnante.
Paprika est un spectacle vertigineux, d’un foisonnement visuel insensé, doté d’un humour touchant et, il va sans dire, d’une classe folle dans la réalisation. Techniquement irréprochable, et d’une créativité sans limites, le film surprend constamment.
On en ressort enchantés, secoués, émerveillés, de ces sentiments devenus si rares à la sortie d’une salle de cinéma.
Difficile d’exprimer à quel point la narration touche ici au sublime. Elle devient ainsi sujet du film, sans jamais tourner à la théorie intellectualisée. Opposant, mélangeant, triturant, fusionnant réalité et rêve, Satoshi Kon trouve avec Paprika le sujet idéal pour exprimer le génie de son cinéma et la virtuosité de sa mise en scène. Comme souvent avec les grands films cela tient d’une apparente simplicité. Mais derrière ce qui pourrait être en d’autres mains un infernal et incompréhensible capharnaüm se trouve un démiurge qui s’amuse, invente et diverti au plus haut point avec une insolente inspiration. Chapeau bas.